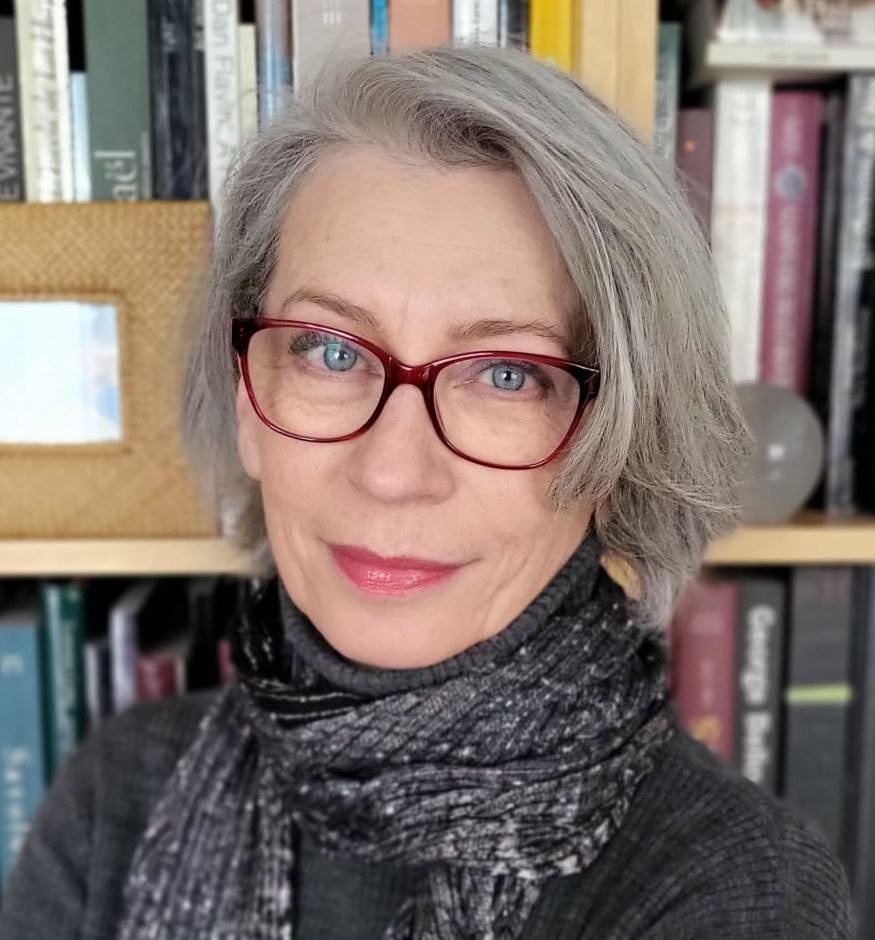Les images de toutes sortes font partie de notre vie quotidienne. Elles s’imposent partout à la vue, presque à chaque instant et quelle que soit la circonstance. Il nous serait probablement impossible de dire, à la fin d’une journée, combien nous en avons perçu, la plupart du temps sans y prêter réellement attention. C’est d’ailleurs le principal ressort de leur efficacité : jouant sur la surprise, la rapidité et la répétition, l’impact de l’affiche ou de la photographie publicitaire est d’autant plus profond qu’on n’a pas besoin d’y penser. Elle pénètre dans l’esprit comme une évidence, comme un phénomène naturel, et finit par s’y installer comme une vérité.
On a peine aujourd’hui à imaginer combien la présence de l’image était autrefois exceptionnelle et quelle puissance elle possédait. En dehors de la gravure qui s’est diffusée à partir du XVIe siècle seulement, l’homme du Moyen Age ou de la Renaissance ne connaissait dans ce domaine que les peintures qu’il voyait à l’église. Le tableau, rare et précieux, y dispensait un enseignement et témoignait d’un savoir commun. On peut même aller jusqu’à dire que la première raison d’être d’un tableau se confondait avec ce besoin d’établir une certitude partagée, quelle qu’elle fût. On peignait ce qui n’était plus là ou pas encore advenu, le Christ ou la Vierge, les saints, l’Enfer ou le Paradis. Derrière toute représentation, il y avait aussi une attente, parfois une peur, de toutes façons un espoir ou une nostalgie. Dans la tradition chrétienne comme dans le monde antique, la fonction de l’image, avant même de visualiser l’histoire qu’on ne savait pas lire, était de combler un vide, de compenser une absence.
Ainsi, Pline raconte que la fille d’un potier de Corinthe traça sur un mur avec du charbon l’ombre portée de son amant qui partait en voyage, afin de garder une trace de lui jusqu’à son retour. Son père, voyant cela le lendemain, eut l’idée d’en tirer une forme modelée. Ce jour-là, il inventa la sculpture, comme elle venait d’inventer l’art de la peinture… L’apparition du portrait miraculeux du Christ sur le voile de Véronique ou la légende de saint Luc peignant la Vierge avec sa divine intervention, fondent une autre légitimité, d’ordre métaphysique, cette fois.
Tout cela paraît bien lointain, et, depuis, l’image s’est diversifiée, ouverte à tous les aspects de la vie profane. Elle s’en est trouvée allégée, le relais a été assuré par le livre puis par la photo. Cependant, la relation actuelle que nous avons aux images peintes reste marquée en profondeur par l’enchevêtrement de ces différents récits d’origine, et mêle l ‘émerveillement devant la prouesse technique, la dimension affective et le respect religieux au sens le plus large du terme.
C’est, très probablement, ce qui explique le rôle particulier de la peinture, dans le paysage culturel d’aujourd’hui. Sa fonction a changé et la situation s’est retournée puisque nous vivons immergés dans les images. Pourtant, malgré cela, et au fond à cause de cette surcharge visuelle, la peinture attire plus que jamais. la constatation se nuance dès qu’il est question de peinture contemporaine, puisque, par définition, comme un verre grossissant, celle-ci insiste sur certains aspects caractéristiques de notre époque, qui vont du désarroi spirituel à l’obsession du déchet en passant par le goût de l’autodestruction…
Comme la fille du potier dont la solitude fut adoucie par l’ombre dessinée de son amour, nous trouvons au contraire dans la peinture du passé une forme de paix.
L’affluence dans les expositions, et notamment dans les grandes rétrospectives ne peut se justifier par le seul effet de la mode. Les motivations des visiteurs, pour n’être pas toujours formulées, semblent liées à d’autres besoins.
Dans le face à face avec la peinture, c’est d’abord le privilège d’une rencontre qui se joue, un antidote à la banalité. Regarder un tableau constitue l’une des rares possibilités de percevoir une image unique, première et fondatrice. Et, à se tenir devant elle, on retrouve quelque chose de sa propre unicité…
Quelque chose, aussi des qualités irremplaçables du monde et par conséquent de la relation que l’on entretient avec lui. En opérant un choix dans le visible, en articulant les formes et les couleurs d’une composition, le peintre propose non pas une imitation des choses, mais leur commentaire. Le tableau ne reproduit pas, il désigne, exhibe, et, ce faisant, réactive et renouvelle la perception.
Ce qu’on attend d’un tableau aujourd’hui n’est plus de l’ordre du savoir, et les gens qui se pressent dans les musées ou dans les conférences sur l’art n’ont pas tous, loin s’en faut, la fibre historienne. La recherche d’un sens, la quête d’une cohérence, l’acuité retrouvée d’une sensation comptent davantage. Sans les éblouissants drapés des frères mercédaires de Zurbaran, saurait-on aussi bien ce qu’est la pesanteur d’une étoffe qui retombe lourdement sur la pierre et la caresse un peu…
Echappant au développement linéaire qui régit la musique ou la littérature, le tableau existe tout entier au présent. Cette immédiateté apparente fait sa force. Il n’a pas besoin de devenir, il est, ici et maintenant. Limité par ses quatre bords, délimitant nettement un espace, il se présente à priori comme une figure de la concentration et du recueillement. tout tableau, dans cette mesure, s’oppose à la notion d’un temps qui passe et qui échappe, autant qu’à l’émiettement, à la dispersion de la pensée. Il rassemble, organise, et celui qui s’y arrête, à son tour, a une chance, pour un instant, d’y retrouver l’écho de sa propre unité.
Peintre de la jubilation, de l’accord parfait entre sensualité et spiritualité, Matisse découvrit sa vocation de peintre lorsque sa mère lui offrit une petite boîte de peinture, pour le distraire sur le lit d’hôpital où il se reposait d’une opération. Par la suite, la peinture garda toujours pour lui cette mystérieuse vertu grâce à laquelle le bonheur esthétique se colore d’un sentiment d’épanouissement, de plénitude physique. Et elle se devait, selon lui, de transmettre cela à chacun…
Des années d’enseignement m’ont appris à quel point Matisse avait raison, et pas seulement, bien sûr, pour sa propre peinture. Il y a quelque temps, au sortir d’un cours, un ancien professeur de littérature, l’un de ces messieurs érudits à la culture précise et sensible, me murmura ces quelques mots : «Il me semble, comment dire, que la peinture me guérit…»
Rien de plus naturel, sans doute. D’ailleurs, au Moyen âge, les peintres florentins n’appartenaient-ils pas déjà à la même corporation que les médecins et les apothicaires …
Françoise Barbe-Gall
Paris (Francia)